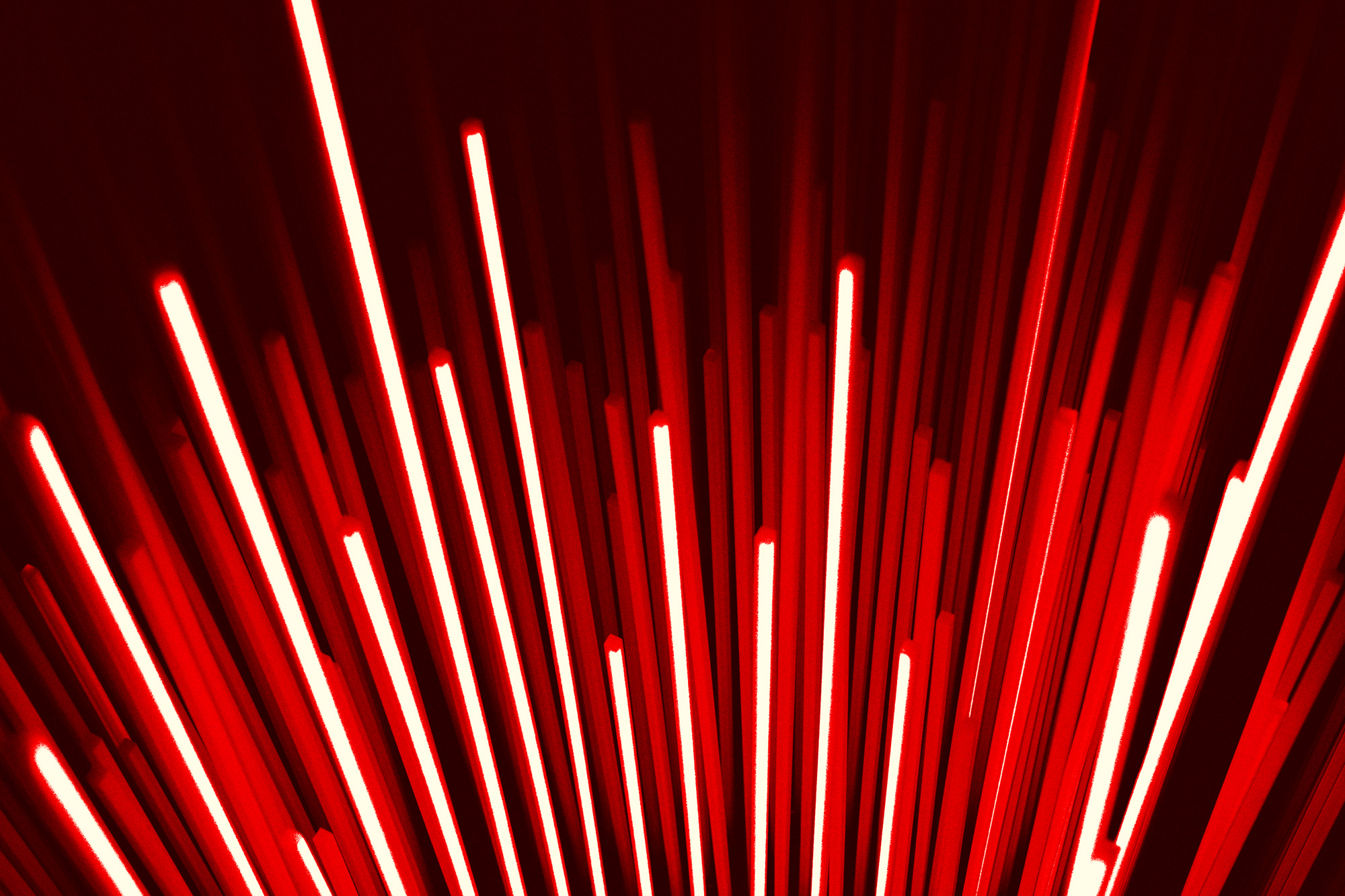20 Mar CAS Rythmes urbains et sécurité : les essentiels #3 Ville nocturne
Le Laboratoire de Sociologie Urbaine – LaSUR et iSSUE s’associent pour offrir aux professionnel·le·s qui gravitent autour de la ville au sens large (urbanisme, mobilité, sécurité, travail social, événementiel…) une nouvelle opportunité de formation continue qui démarrera en septembre 2025 : le Certificate of Advanced Studies (CAS) « Rythmes urbains et sécurité – Travailler ensemble face aux enjeux de la cohabitation urbaine ».
Ce programme propose une approche novatrice de la gouvernance des villes, basée sur les recherches et expériences récentes. Les variations d’intensité entre le jour et la nuit, la semaine et le weekend, le quotidien et l’événementiel posent des questions en matière de cohabitation et de sécurité. Quels sont par exemple les enjeux autour du premier et du dernier bus, des incivilités commises dans les transports ? Le CAS invite à découvrir la sécurité urbaine sous un œil nouveau et dans une perspective interdisciplinaire. L’analyse de nombreuses études de cas amènera les participantes et participants à réfléchir aux notions de sécurité, de rythmes, de mobilité et à leurs interdépendances.
Le webinaire de présentation du CAS qui s’est tenu le 25 novembre 2024 portait sur le thème « Ville nocturne ». Il était animé par Pascal Viot, directeur d’iSSUE et coordinateur du CAS, en collaboration avec Luc Gwiazdzinski, Professeur en Ville et Territoires à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse, et Chloé Montavon, doctorante au sein du LaSUR. Il peut être visionné ici :
https://www.youtube.com/watch?v=NYxpWK31RWQ&list=PLECIyfSwB54Kzfkwpz_IwfGc2P5P0kwwD
Le contenu du webinaire en bref
Lorsqu’on étudie la façon dont les gens circulent en ville, on se rend compte que les modes de circulation et les trajets ne sont pas les mêmes entre le jour et la nuit, et que des endroits populaires de jour perdent leur attrait la nuit venue. Les politiques ne se sont longtemps intéressées à la nuit que pour la contrôler. Dans les années 1990, on a assisté à une forme de colonisation de la nuit, qui a démarré dans les grandes métropoles, puis s’est généralisée aux villes de taille moyenne. Cette nuit qui semblait oubliée, marginale, a commencé à occuper une place grandissante en matière de développement économique, de vivre ensemble, de cohabitation. La vie nocturne est devenue un facteur d’attractivité. Aujourd’hui, une ville moderne et dynamique est une ville qui vit 24 heures sur 24.
L’exemple de la ville de Montréal
La ville 24h/24 est dorénavant un argument touristique. Mais se pose la question de la cohabitation avec les habitants, qui eux ne sont pas sur un mode 24h/24. On est aujourd’hui dans des villes polychroniques, des villes à plusieurs temps. On ne se lève et on ne se couche plus aux mêmes heures.
Montréal possède une identité nocturne et festive forte. Désireuse de faire de cette fierté territoriale un outil de marketing, elle a développé une approche spatiale, avec des quartiers 24h/24, et un réglementation du bruit spécifique pour assurer la qualité de vie des différentes populations.
Des diagnostics nocturnes ont également été réalisés à Sydney ou New York, par exemple. En Europe, on a vu apparaître des états généraux de la nuit. Rassemblant les politiques, les chercheurs, les chambres de commerce et les acteurs de la nuit, ils traitent de thématiques telles que les décalages de service en soirée, l’éclairage ou l’instauration de correspondants de nuit. La nuit est ainsi passée d’un espace-temps caractérisé par la crainte, la peur ou le contrôle à une sorte de politique d’innovation.
Éclairage public en un clic
Il s’agit ici de la mise en place d’un projet d’éclairage public à la demande, que l’on peut actionner avec son smartphone. L’éclairage est associé à des thématiques telles que l’économie d’énergie et d’argent, l’usage des nouvelles technologies, la sécurité ou encore la protection de la biodiversité. On peut se demander :
► Qui sont les personnes qui utilisent l’espace public la nuit ?
► L’obscurité est-elle un facteur de risque ? Faut-il éclairer la nuit pour qu’elle ressemble au jour, gommer les spécificités de la nuit avec un éclairage généralisé ?
► Et si mon téléphone tombe en panne, est-ce que je me sens encore en sécurité ?
L’accessibilité à la nuit
L’espace public appartient à toutes et tous. Mais cet accès est-il garanti en tout temps ? De fait, bien des débats nous montrent aujourd’hui que cette accessibilité n’est pas garantie, notamment pour les femmes.
Dans cet extrait, on constate :
► que s’exprime une forme d’anxiété, de crainte dans l’accès à l’espace public, avec une perception du danger qui est décuplée du fait du régime nocturne. La nuit vient ici agir comme un exhausteur de dynamiques sociales qui étaient déjà présentes le jour.
► que les femmes déploient des techniques individuelles. Les enjeux sont donc renvoyés à la personne elle-même qui doit se protéger contre cet environnement perçu comme hostile ou dangereux.
Ce qui est également marquant, c’est le contraste avec les situations de foule urbaine abordées dans le webinaire précédent (https://www.youtube.com/watch?v=QXVBmcYLMIQ). Dans une foule, la crainte de l’agression sexuelle est associée à la présence d’un grand nombre de personnes. Ici, le risque émerge de l’impression de solitude qu’ont ces femmes dans l’espace public la nuit. Dans ce contexte, toute personne rencontrée est un potentiel agresseur. L’opportunité de la rencontre qui est le propre de l’espace public est là uniquement connoté négativement. Bien que ces femmes développent des techniques individuelles pour contrer leur sentiment d’insécurité, on voit qu’il s’agit d’un phénomène collectif et genré.
Les questions qui se posent sont :
► Comment répondre à l’aspiration légitime des femmes à se sentir en sécurité dans l’espace public ?
► Comment faire en sorte que la rencontre ne soit plus seulement une rencontre qui inquiète mais une rencontre qui rassure ? Grâce à des correspondants de nuit, des agents de sécurité, des agents de police, des acteurs sociaux ?
► Comment repenser l’écosystème complet pour améliorer l’accès à l’espace public la nuit ? Par l’éclairage, l’aménagement de bus et d’arrêts de bus supplémentaires, ou de magasins refuge ?
Pour plus d’informations sur la situation lausannoise en matière de harcèlement de rue, vous pouvez consulter ces deux articles : https://www.lausanne.ch/apps/actualites/Next/serve.php?id=6664
https://lausannecites.ch/articles/une-application-pour-demander-de-laide-en-cas-de-harcelement
Réflexions
Les pouvoirs publics ont permis le travail de nuit et le développement de commerces et d’activités nocturnes. On a donc une population qui est là et qui a droit aux mêmes services que la journée, au même contrôle, à la même sécurité et à un espace public hospitalier de qualité. La nuit ne se limite pas à la fête, c’est toute une vie sociale qui se déroule dans cette temporalité-là. Elle donne aujourd’hui lieu à des expérimentations techniques, sociales ou politiques qui devront être évaluées et ajustées. Car la solution ne sera jamais définitive, parce que les populations ainsi que le contexte climatique et politique changent.
Envie d’en savoir plus sur le Certificate of Advanced Studies Rythmes urbains et sécurité ? Inscriptions et informations ici : https://www.formation-continue-unil-epfl.ch/formation/rythmes-urbains-securite-cas/