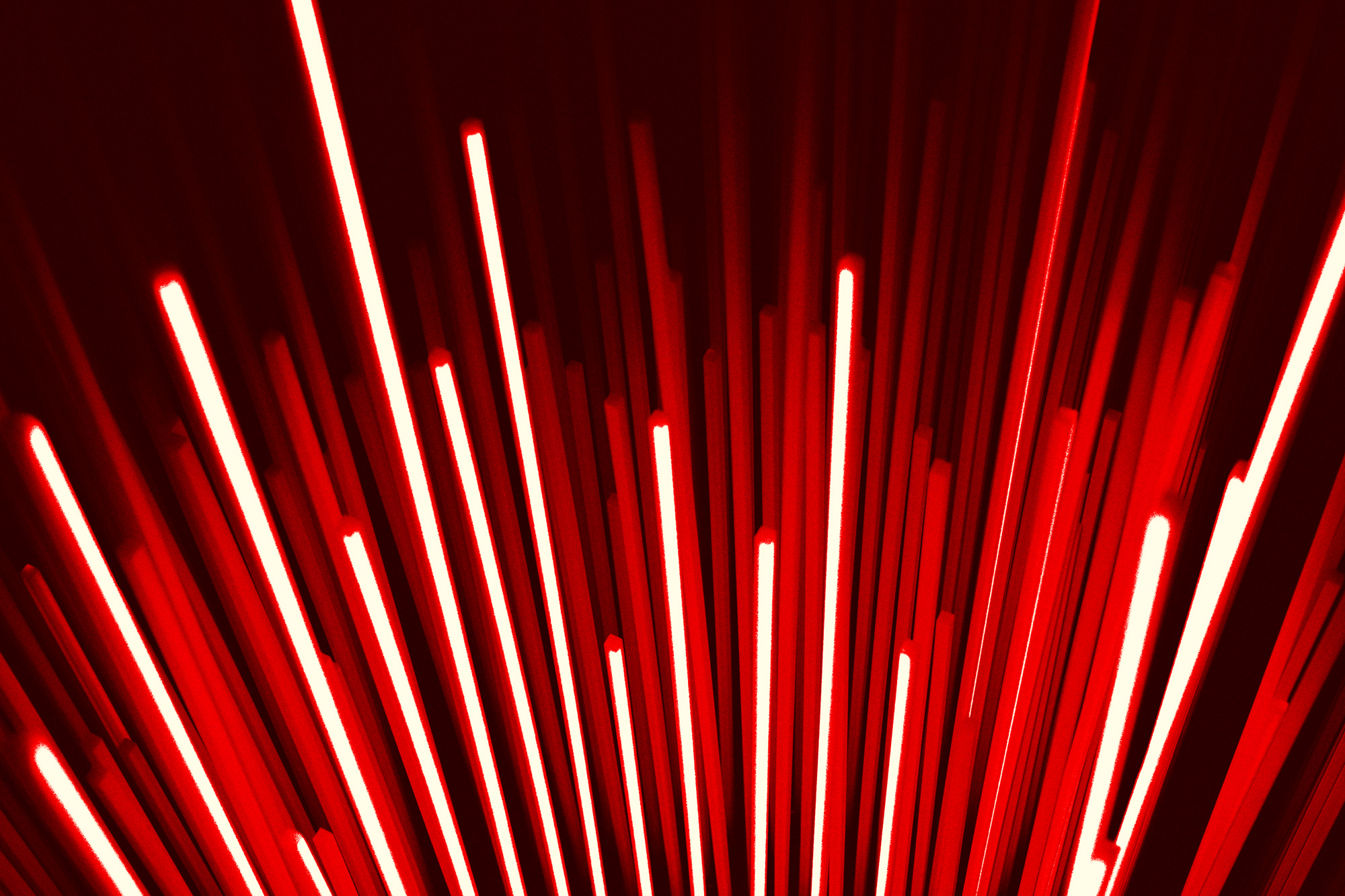04 Avr CAS Rythmes urbains et sécurité : les essentiels #4 La sécurité urbaine en question(s)
Le Laboratoire de Sociologie Urbaine – LaSUR et iSSUE s’associent pour offrir aux professionnel·le·s qui gravitent autour de la ville au sens large (urbanisme, mobilité, sécurité, travail social, événementiel…) une nouvelle opportunité de formation continue qui démarrera en septembre 2025 : le Certificate of Advanced Studies (CAS) « Rythmes urbains et sécurité – Travailler ensemble face aux enjeux de la cohabitation urbaine ».
Le webinaire de présentation du CAS du 10 février 2025 portait sur le thème « La sécurité urbaine en question(s) ». Il était animé par Pascal Viot, directeur d’iSSUE et coordinateur du CAS, en collaboration avec Mathias Schaer, délégué à l’Observatoire de la sécurité de la Ville de Lausanne, Dre Sarah Girard, consultante et chercheure en sécurité urbaine, et Chloé Montavon, doctorante au LASUR. Il peut être visionné ici :
Les questions de sécurité – plus fréquemment présentées sous l’angle de l’insécurité – sont au cœur des débats publics. Les politiques de sécurité urbaine actuelles sont constamment en tension entre :
► une vision rationnelle, une exigence de résultat dans le cadre d’un projet politique, qu’on puisse mesurer au moyen de statistiques
► et une vision plus subjective associée à des perceptions, des sentiments,
► une approche répressive (police)
► et une approche sociale.
Comment trouver une voie qui aille au-delà de cette dualité ? En additionnant les ressources et les compétences et en s’éloignant d’une approche axée sur les résultats pour s’orienter vers l’expérimentation.
La sécurité urbaine dans l’histoire
Les enjeux de sécurité urbaine ne datent pas d’hier, et une lecture historique de cette question invite à faire preuve d’humilité. Si une solution universelle permettant de garantir durablement la tranquillité publique et le vivre-ensemble existait, elle aurait sans doute déjà été mise en œuvre. En réalité, les problématiques liées à la sécurité en ville ne cessent de se poser encore et encore, sous des formes renouvelées, car elles sont profondément liées aux dynamiques sociales, aux rapports de pouvoir, aux évolutions urbaines et aux sensibilités collectives propres à chaque époque.
Face à des situations perçues comme critiques, souvent mises en exergue par des événements médiatiques marquants, les réponses politiques tendent à privilégier des solutions immédiates, parfois simplistes, qui occultent la complexité du sujet. Or, les politiques de sécurité urbaine ne peuvent être pensées hors sol : elles doivent être contextualisées, adaptées aux territoires et attentives aux temporalités sociales dans lesquelles elles s’inscrivent.
C’est pourquoi il est crucial de prendre du recul, de refuser les évidences trop commodes, et de remettre sans cesse en débat ce que recouvre réellement la « sécurité urbaine » : quelles peurs, quels publics, quels espaces sont visés ? Redéfinir les termes et les enjeux devient alors un impératif pour ne pas céder aux réflexes gestionnaires de court terme et pour penser des réponses plus justes, plus ancrées, et plus durables.
Étude de cas : la nuit lausannoise
L’une des caractéristiques de la ville de Lausanne est son caractère festif à la fois porteur de promesses, de valeurs, mais aussi d’un certain nombre de nuisances, voire de risques. Les soirs de week-end, un grand nombre de noctambules y affluent d’un peu partout en Suisse. Au tournant des années 2010, une montée en intensité des débordements s’est fait sentir. Un certain nombre d’incidents ou de problèmes de sécurité manifestes ont été reportés dans les médias, amenant à une prise de conscience et au déploiement d’une politique de sécurité. L’Observatoire de la sécurité de la Ville de Lausanne a été mobilisé pour coordonner les mesures prises, sur un mode expérimental. Quelles actions entreprendre pour pacifier les nuits lausannoises ?
Les mesures étaient à la fois :
► restrictives voire répressives (liberté qu’on donne aux établissements pour ouvrir ou pas, contraintes dans la gestion de l’établissement, exigences vis-à-vis du personnel de sécurité, nombre d’agents par établissement, restriction des horaires de vente d’alcool dans les commerces en soirée, etc.)
► mais aussi préventives ou réflexives sur la vie nocturne à Lausanne (mise en place d’une équipe de médiation urbaine qui va à la rencontre des noctambules pour les responsabiliser dans l’usage qu’ils font de l’espace public le soir et rapporte ses constats à l’Observatoire qui les partage avec d’autres services de la ville)
Le cas lausannois illustre l’importance de la mise sur agenda de la sécurité publique en mode nocturne et festif. De façon générale, il souligne l’importance de penser ensemble une logique de traitement à court terme en matière d’intervention et un travail à plus long terme de gestion des risques, par le biais d’une approche intégrée entre acteurs publics et privés.
Sécurité et rapports sociaux
Plus globalement, la question de l’insécurité vient toujours s’ancrer dans le contexte social de l’époque. Aujourd’hui, les enjeux de sécurité urbaine intègrent de façon croissante la problématique du harcèlement de rue et la crainte des femmes à déambuler dans l’espace public. De fait, si les usages de l’espace public sont divers, les profils des personnes qui le fréquentent le sont aussi. Il devient dès lors difficile de s’accorder sur les normes d’interaction qui pourraient garantir le vivre ensemble.
Le harcèlement de rue apparaît comme un problème public majeur à partir des années 2010. Cette notion est définie comme un continuum de violences allant des sifflements et regards insistants aux agressions physiques et viols, actes fondés sur la domination masculine. Il n’y a pas besoin de violence effective pour que ce soit vécu comme de la violence. De même, cette insécurité n’est pas perçue de la même manière en fonction des caractéristiques sociales des personnes.
Le deal de rue est perçu comme problématique à la fois parce qu’il renvoie au trafic de drogue mais aussi (et peut-être surtout) parce qu’il est également associé à une forme de harcèlement. Les comportements qu’il engage constituent en effet ici aussi ce que l’on pourrait qualifier « d’infractions civiles », comme des regards insistants, des interpellations.
👉 Comment dès lors penser un mode de gestion politique et opérationnel du problème, de façon pragmatique et non-dogmatique, garantissant des résultats concrets et rapides tout en acceptant une part d’expérimentation face à un problème récalcitrant et complexe ? C’est le défi posé aujourd’hui aux gestionnaires des villes.
Pour comprendre ces situations, il est important de prendre en compte les rapports sociaux qui s’y jouent et de redéfinir ce qui est vécu comme de la violence ou de l’insécurité pour adapter les pratiques de sécurité. Dans le harcèlement de rue tout comme dans le deal de rue, un point crucial réside dans le décalage produit par ces phénomènes par rapport aux attentes de comportements dans l’espace public. On ne s’attend pas à ça, on se sent dévalorisé.e, victime, insécurisé.e du fait de cette interaction ressentie comme inappropriée.
👉 Comment la politique intègre-t-elle ce registre émotionnel sans pour autant verser dans la démagogie ? Comment mettre au cœur des politiques publiques la question de l’expérience ? Quel dispositif imaginer pour réguler ou traiter ces situations d’infractions civiles ?
L’Observatoire de la sécurité de la Ville de Lausanne est dans une position médiane entre des problématiques de société – comme le sexisme ou la consommation de drogue – et des aspirations légitimes de confort dans la ville. On ne peut pas nier la gêne de la population au contact de dealers, de personnes toxicomanes ou d’hommes au comportement inadéquat. Les tensions, frictions sont omniprésentes et la cohabitation difficile à garantir. Il s’agit alors d’œuvrer afin que la situation reste dans les limites du convenable, proposer une logique de médiation pour que tout le monde trouve et occupe sa place dans la ville. L’expérimentation est au centre de cette mission qui devrait être partagée entre la police, le travail social, la propreté urbaine et l’aménagement de l’espace public.
Cohabitation émotionnelle
Quand la population se trouve dans un état de trop-plein émotionnel face aux incivilités, comment réagir en tant que professionnel et maintenir le dialogue ? Comment respecter la dignité de la personne qui a peur pour ses enfants à cause du trafic, qui n’arrive plus à dormir la nuit à cause du bruit, tout en sachant que la réponse ne sera peut-être pas à la hauteur de ses attentes ?
L’interaction avec les habitants ou les commerçants sur ces sujets sont rarement pacifiés. Le risque est alors celui d’un cercle vicieux fait d’attentes des habitants exprimées sur un mode relativement émotionnel et d’une traduction politique de ces plaintes ou craintes dans le registre du « nous allons faire quelque chose » – avec un horizon de résultat, donc une promesse, malheureusement souvent impossible à tenir.
👉 Si on veut sortir de ce cercle vicieux, que peut-on inventer comme dispositif, innovation, expérimentation pour favoriser la cohabitation urbaine ?
👉 Pourrait-on par exemple inclure les personnes concernées (émetteurs de la plainte comme destinataires de celle-ci) dans la conception des solutions et les processus de décision et de planification afin d’éviter de s’appuyer sur des clichés ?
Avant la prise de décision, le diagnostic
Faut-il éclairer plus, éclairer moins, éclairer différemment ? Faut-il plus de présence ? De qui ? Comment ? Les décisions informées se fondent sur des données, mais comment collecter ces dernières pour arbitrer entre des positions divergentes ?
L’établissement de diagnostics de sécurité associe statistiques et approche qualitative. Les statistiques policières sont ainsi couplées à des rencontres sur le terrain :
► Rencontres avec les différents partenaires pour découvrir ce qu’ils comprennent les uns des autres. Savoir comment l’autre travaille, ce qu’il a le droit de faire et où s’arrêtent ses prestations est une étape nécessaire pour instaurer de la sécurité.
► Rencontres avec les habitants afin de recueillir leurs ressentis et d’apprendre à identifier ce qu’il y a derrière des propos violents, un « Je me sens en insécurité » ou « Je veux une caméra devant chez moi ».
Ces rencontres permettent de nourrir le diagnostic et de susciter l’adhésion de toutes les parties prenantes à un projet commun. Libres à elles ensuite d’innover, d’élaborer leurs propres outils, d’expérimenter, d’échanger pour aller plus loin, obtenir le soutien des politiques et pérenniser la démarche.
Source et crédit photo : journal 24 heures